Si la création est une tempête,
Je me laisserai bercer
Il m’est venu l’envie de créer un endroit où je pourrais me déverser, sans me demander sous quelle forme. J’ai besoin d’un espace sans normes et sans contraintes où peuvent cohabiter les images, les mots et la musique. Je retourne à l’adolescente qui parcourait les blogs colorés aux balbutiements de la bête qu’est devenu internet. Il y avait là des microcosmes qui se relayaient, m’amenant chaque fois dans de nouveaux univers. Voici donc le mien.
Ici les idées seront empilées jusqu’au plafond, mais jamais dans la honte d’avoir trop voulu garder. Je ne promets rien. Je ne promets ni théâtre, ni roman, ni éditorial. Ce pourra être tout ça et rien à la fois. Il n’y aura ni date butoir, ni obligation, ni absence. Les mots resteront sur les pages jusqu’à ce que d’autres les rejoignent sans jamais s’ennuyer.
J’ai besoin de faire exister l’artiste sans le cirque. Elle est là toujours, fluide. Elle ne dort jamais. Elle observe la ville, les arbres et les visages. Ce n’est pas parce qu’elle ne parle pas sans cesse qu’elle est devenue muette. J’ai décidé de lui offrir enfin une maison où elle n’aura pas besoin de muter à perpétuité pour exister.
Elle y sera, seule et fière.



TABLE DES MATIÈRES
formes courtes
formes longues
1.NaPoMo
National Poetry Month

Chaque avril, on célèbre le mois de la poésie. Plusieurs expressions de cet art font alors surface un peu partout sur le globe. L’une d’entre elles prend la forme d’un exercice d’écriture quotidien.
Les artistes des mots qui le souhaitent se joignent donc au mouvement #NaPoMo en créant chaque jour d’avril, un poème.
La structure a peu d’importance. Il s’agit ici d’une opération dont les limites ne sont posées que par l'artiste qui lui donne vie.
Voici quelques-unes de mes créations.





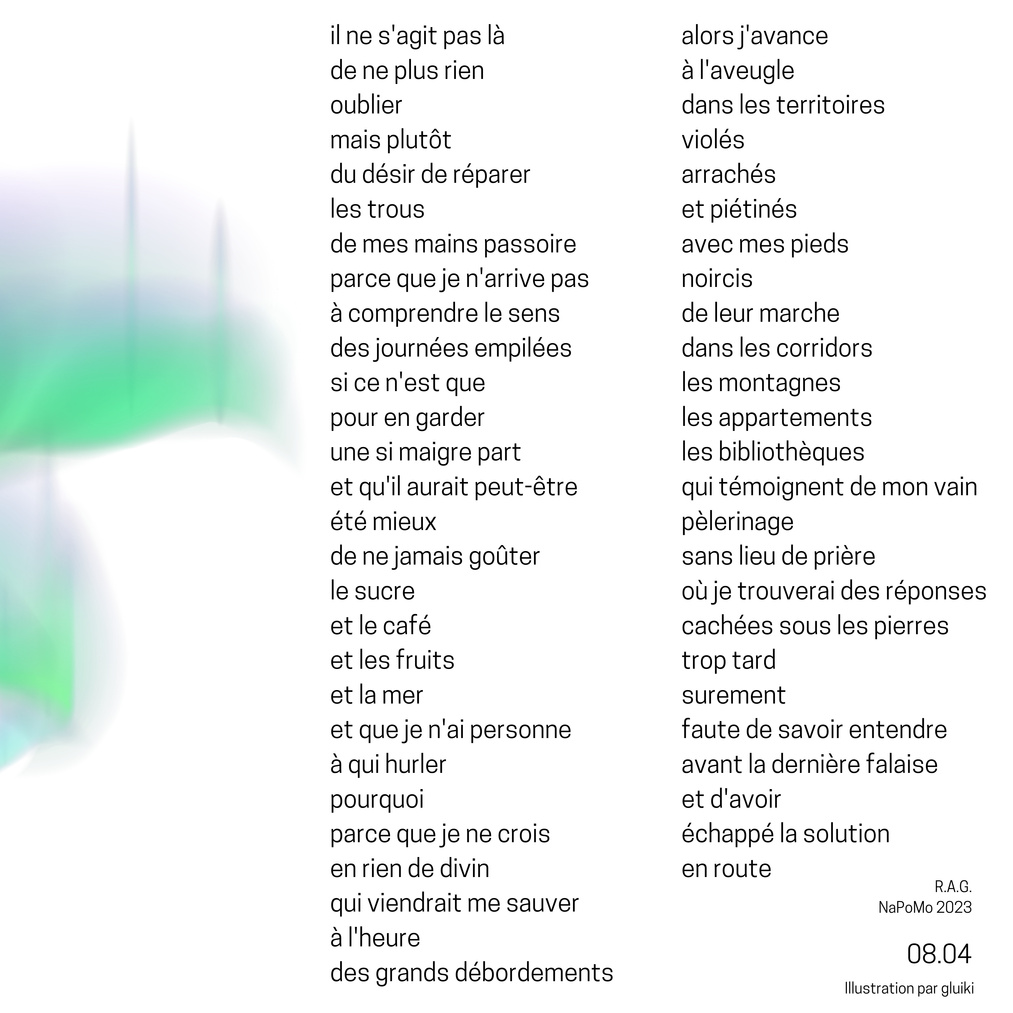

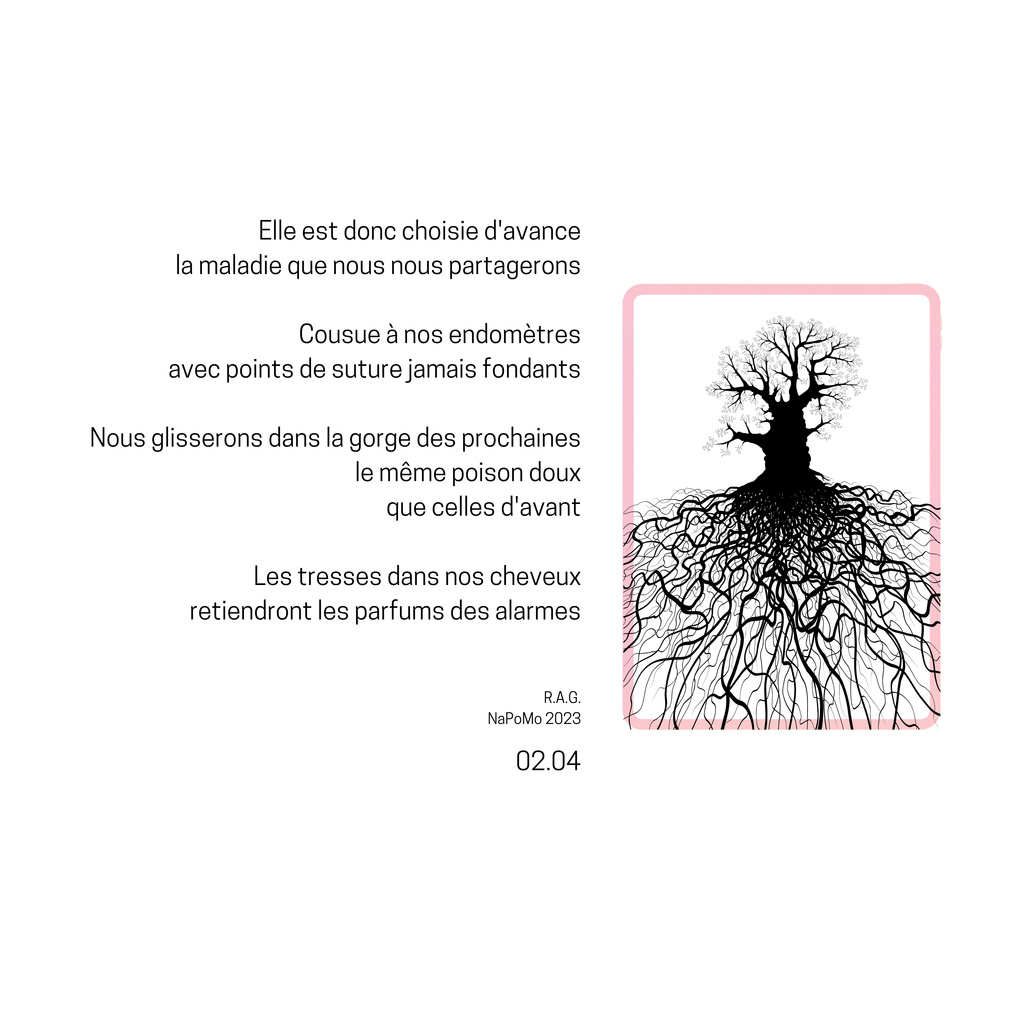



2.TUNNEL
Je suis au volant, seule dans ma voiture, au mi-chemin du tunnel Hyppolite-Lafontaine. La circulation est ralentie, pratiquement arrêtée. Et puis me vient cette pensée. Comme une vision qui frôle le fantasme. J’imagine un tronçon du tunnel qui se rompt. À 500 mètres devant moi une vague immense envahit le corridor bétonné engouffrant avec elle tous les véhicules et leurs habitants sur son passage. La scène se passe dans un ralenti féérique et malgré les habitacles de métal qui se fracassent les uns contre les autres, je n’entends aucun son. Je vois le déferlement qui s’apprête à m’engloutir et aucune pensée ne traverse mon esprit. Je suis là devant ma mort imminente et je ne trouve rien à me dire. Je ne ressens ni la terreur, ni la détresse, ni le regret, ni la colère d’être morte sans le vouloir particulièrement. Je me sens comme quand je plonge tout mon corps sous l’eau du lac et que je m’efforce de rester au fond sans trop bouger. Les sons deviennent de vagues échos et je reste dans cette réplique gigantesque du placenta de ma mère jusqu’à ce que mes poumons me menacent d’imploser. Je me dis que c’est probablement ce que je sentirais si la vague avalait ma voiture en faisant éclater les fenêtres. Je me retrouverais rapidement entourée du fleuve, flottant à l’envers, couchée sur le plafond de mon auto. Tout ce que je possède me semblerait alors futile. À quoi bon classer mes livres par ordre alphabétique si je finis de toute façon par mourir tragiquement étouffée par le fleuve, les poumons éclatés, sans ne les avoir jamais lus.


1.COMME SI JE ME REGARDAIS DISPARAÎTRE
Je n’arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne pourrais pas dire quand exactement. Quand je m’en suis réellement rendue compte, ça faisait déjà longtemps que je perdais des morceaux. Je me suis d’abord dis que c’était sans doute la fatigue. Tout le monde est fatigué maintenant. On en parle constamment, on en rit, comme d’un mal dont nous sommes tous affligés. Alors j’ai pensé que, comme tout le monde, j’avais atteint un âge où je serais désormais condamnée à l’épuisement perpétuel. Mais en y pensant davantage, j’ai bien compris que ce n’était pas que les cernes le problème. J’ai ensuite pensé que peut-être, c’était toi. J’en suis désolée mon amour. Je ne voyais pas l’ampleur des dégâts. Je ne voyais pas ce qui s’enracinait bien plus creux que tout ce que tu es dans ma vie. J’ai pensé que c’était mes hormones qui étaient mal programmées. Un débalancement de quelque chose que je ne comprends pas. J’ai vu un médecin. Quand on est malade on se soigne. Mais apparemment je n’avais rien à guérir. C’était normal, me disait-on, que je change. À 26 ans, on est plus comme on l’était à 16. Les choses se placent, les choses s’établissent. Tout ce que je réussissais à entendre à travers ces phrases aussi ennuyantes que moi était que j’était maintenant entré dans un cul-de-sac et que je n’en sortirais pas. « Vous les jeunes femmes, vous avez tendance à vivre ce qu’on appel de l’anxiété de performance » m’a-t-il dit. « Ça peut influencer beaucoup votre quotidien ». Si seulement, que je me disais. Si seulement je sentais cette pression dont il me parlait. Je sais ce que c’est que cette boule électrique qui tient notre diaphragme en otage. Je la connais. Mais elle ne m’habite plus. Jamais.
Le problème est que plus rien ne m’habite jamais. Ce que je crains, ce qui m’est apparue, ce ne sont pas les symptômes de quelque mal-être que ce soit. Ce qui m’inquiète c’est le manque de symptômes. Le manque de peur, l’absence de nostalgie, l’assourdissement des joies profondes, de l’excitation étourdissante. J’ai maintenant compris que ce qui ne tourne pas rond ce n’est pas que je ne me sente pas bien. C’est que je ne me sente pas. Ma tête sait ce que mon corps devrait sentir, mais la connexion ne s'établit plus. J’avais l’habitude de me sentir tellement vivante. L’odeur de l’automne suffisait à me ramener à quand j'étais toute petite et que mes parents et moi allions marcher dans la forêt. Une nostalgie douce et chaude comme un feu de cheminée pendant une panne de courant. Quand je me retrouvais face au lac qui m’a vu grandir, en quelques secondes à peine j’étais bouleversée par sa force et sa beauté. Complètement submergée par l’émotion, je me trouvais devant lui comme devant un orchestre symphonique. Et tes mains, mon amour. Tes mains à elles seules avait le pouvoir de faire frissonner tout mon corps. Nous étions comme des morceaux d’aimants. Brisés quelque part en chemin, mais tellement solides une fois ensembles. Connectés par une force que seuls les physiciens comprennent. Nous faisions l’amour comme si c’est nous qui avions inventé le sexe. Nous nous disions que personne ne pourrait jamais comprendre comme c’était bon d’être nous. Et j’ai tout de même douter de toi. Avant que je comprenne que c’est mon corps qui s’endormait, j’ai pensé que peut-être le temps avait eu raison de notre naïveté d’amoureux. Peut-être qu’ils avaient raison finalement les autres malheureux qui disaient que le feu finit toujours par devenir braises, puis cendres, puis rien. Alors je me suis demandé si je ne serais pas plus heureuse dans d’autres bras. Je sais, pardonne-moi.
Je me suis mise à chercher qui pourrait bien me faire sentir les bouillonnements que je ne sentais plus. Mais j’avais beau ratisser mes fantasmes, rien ne réchauffait mon ventre. Peu importe à qui je pensais : rien. C’est là que j’ai compris. Je me suis mise à vider tous les tiroirs de ma tête à la recherche de quelque chose qui me secouait. J’ai réécouté les chansons qui me faisaient pleurer, je suis retourné voir mon lac, j’ai essayé de sentir l’automne, la pluie, d’écouter les orages, j’ai essayé de danser, de boire, de sortir, de manger, de partir, de revenir. J’ai essayé de te retrouver. C’est là que j’ai compris. Je me suis mise à vider tous les tiroirs de ma tête à la recherche de quelque chose qui me secouait. J’ai réécouté les chansons qui me faisaient pleurer, je suis retourné voir mon lac, j’ai essayé de sentir l’automne, la pluie, d’écouter les orages, j’ai essayé de danser, de boire, de sortir, de manger, de partir, de revenir. J’ai essayé de te retrouver. Mais le lit qui nous avait vu brûler est devenu un territoire étranger. Et peut importe ce que je fais : rien. Je suis vide. Je ne sens ni la peur, ni l’envie, ni la joie, ni la passion. Je suis aseptisée comme si on avait nettoyé mon intérieur à l’eau de javel et qu’il ne me restait que le souvenir des couleurs que j’avais l’habitude d’être. Je me sens comme au sommet d’une montagne, seule. Je vois tout autour. C’est magnifique, je n’ai aucune raison d’y être malheureuse. Pourtant tout en bas est trop petit pour que je puisse le voir vraiment. Et tout est trop loin pour que je puisse l’atteindre. Autour de moi, des dizaines d’avenues pour redescendre mais aucune que je sache parfaitement sûre. Toutes les possibilités sont dangereuses, personne avec moi pour redescendre, je ne connais pas le chemin pour rentrer.


2. LA FIN
Plus je vieillis et plus quelque chose pousse en moi. Pas dans le bas de mon ventre, là où ils attendent impatiemment qu’un enfant éclose. C’est plus haut. Ici.
Pointant son plexus solaire.
Un arbre, je pense. Ses racines coulent lentement dans mes reins. Ses branches s’étendent de plus en plus vers ma poitrine. Pour l’instant, je n’essaie même pas de le tailler. J’ai déjà essayé plus jeune, mais ça ne nous a pas trop servi, ni à moi, ni à lui. Alors je le laisse être. J’ai dû l’avaler un jour en me tenant au milieu d’une forêt de ses pairs.
Forêt.
Je le traîne avec moi depuis. C’est peut-être lui qui me rappelle vers une vie plus loin du béton. Surement. Il en demande de plus en plus. Plus il grandit, plus il a soif. Assoiffé, il rêve que je me plante les pieds dans l’eau froide d’un lac d’octobre. On ferait ensuite brûler de petites forêts, tout autour de nous, où la terre enrichie de cendres ferait naître de nouvelles peuplades. On construirait une petite maison à peine visible à travers les branches, la mousse et les rochers. Il y ferait sec. Jamais humide. Toujours frais et chaud à la fois. J’y cuirais du pain. Mon lit sentirait l'encens et la lavande. Les murs y seraient tapissés de livres que je n’ai jamais lu. Une musique remplirait l’air sans qu’on sache jamais d’où elle vient. Le soir venu, je retournerais planter mes pieds au fond du lac. Le visage vers la lune, mon arbre et moi respirerions enfin. Il serait contenté et moi remplie de lui. En parfaite symbiose.
Et pourtant. Il n’y pas de scènes sur les lacs. Alors je reste ici. Plantée au milieu de vous et de tous les autres. Et au lieu d’abreuver mon arbre, j’attends et j’espère qu’il ne m’avalera pas tout de suite en me baladant à travers les immeubles. Je suis une mère dont la progéniture la dévorera. Dans le règne animal on appelle ce genre de comportement la matriphagie. Matri pour mère. Phagie pour manger. Un jour on me retrouvera plantée sur une scène. Les feuilles vers la lune, les racines brisées. Je serai un symbole pour toutes les forêts mortes. Et alors mon corps n’aura plus d’importance. Mes seins. Mes mains. Mes enfants avortés avant même d’être molécules. Mes mots, même. Rien n’aura d’importance. Les hommes pisseront sur mon écorce et les pleureuses se planteront à mes côtés. Nous deviendrons de nouvelles forêts de femmes solidifiées. On nous brûlera toujours, mais nous ne sentirons rien.
Feu.
PHÈDRE
J'ai voulu, devant vous exposant mes remords,
Par un chemin plus lent descendre chez les morts.
J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines
Un poison que Médée apporta dans Athènes.
Déjà jusqu'à mon coeur le venin parvenu
Dans ce coeur expirant jette un froid inconnu ;
Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage
Et le ciel, et l'époux que ma présence outrage ;
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté
Rend au jour, qu'ils souillaient, toute sa pureté.
Orage qui éteint le feu.
Fin
Tellement Baroque
ROSE-ANNE GIRARD